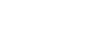L'empreinte eau : un outilstratégique et innovant au service des industriels
Par Alice DEBIASI
On ne cesse de l’entendre : l’eau douce a beau être une ressource renouvelable, les pressions qu’elle subit (hausse de la population mondiale, du niveau de vie, des productions industrielles et agricoles) sont telles qu’elle pourrait un jour venir à manquer. Or l’eau est un facteur de production indispensable au bon fonctionnement de l’activité entrepreneuriale. L’eau est donc en passe de devenir, au même titre que le carbone ou la biodiversité, un enjeu à gérer pour les organisations privées. C’est pourquoi l’empreinte eau, outil récent, complexe et encore mystérieux, dont le développement au sein des entreprises s’amorce à peine, suscite l’intérêt et la curiosité des entreprises et va, à terme, devenir un concept aussi connu et utilisé que le bilan carbone ou les ACV.
L’empreinte eau : un outil récent doté d’une histoire
Si l’empreinte eau est encore méconnue, l’eau virtuelle, son ancêtre, l’est encore plus. L’eau virtuelle est un concept né au début des années 90 des travaux de John Anthony Allan. L’universitaire, surpris de ne voir aucune des guerres de l’eau annoncées se réaliser, finit par découvrir que les Etats, plutôt que de se battre pour cette ressource vitale mais inégalement répartie, comblent leur déficit en eau douce grâce à l’eau virtuelle. Via le commerce mondial, le pays importateur achète en même temps que les denrées et produits l’eau nécessaire à leur production, dont il ne dispose pas lui même. Cette eau, c’est l’eau virtuelle.
Le concept suscite un véritable engouement dans le monde universitaire qui y voit l’occasion de réduire, voire d’anéantir, les maux d’eaux. Leurs travaux donnent naissance à l’empreinte eau, dont le sujet d’étude est l’Etat. Il s’agit d’évaluer toute l’eau directe et indirecte utilisée pour la production des biens et services consommés par les habitants du pays en question ainsi que l’eau utilisée pour fabriquer les produits destinés à l’exportation (l‘empreinte eau interne), et également l’eau importée par le biais de produits pour soutenir la consommation nationale (l’empreinte eau externe). Trois « types » d’eau composent l’empreinte eau :
- L’eau bleue = volume d’eau prélevée dans les cours d’eau de surface (rivières, lacs, …) ou dans les eaux souterraines (nappes phréatiques, nappes fossiles, …).
- L’eau grise = volume d’eau qu’il serait nécessaire d’utiliser pour diluer les polluants usités, et ce jusqu’à atteindre les plafonds légaux (normes d’eau potable, norme OMS…). L’eau grise est encore le sujet de recherches poussées afin d’obtenir un indicateur plus précis. Si la dissolution est une approche fonctionnelle, elle ne permet pas de prendre en compte un certain nombre de facteurs (cocktail de polluants, durée de vie des produits, …) et soulève des interrogations quand aux normes de référence à adopter.
- L'eau verte = volume d’eau consommée ou évaporée par les plantes lors du phénomène naturel d’évapotranspiration.
Si l’eau verte est particulièrement utile pour les Etats (gestion du territoire et de la politique agricole nationale), elle constitue en revanche plus un indicateur à manier avec précaution qu’un outil pour les entreprises car il leur est difficilement possible d’agir dessus. Les options possibles pour diminuer l’eau verte vont consister en des solutions trompeuses, comme augmenter l’irrigation des cultures ou bien accroitre le rendement des cultures. Or ces choix peuvent entrainer une hausse de l’eau bleue, un type d’eau bien plus important pour une société dans la mesure où il peut être maitrisé et où il est totalement imputable à l’activité de l’entreprise. Toute empreinte eau n’est pas bonne à réduire.
L’empreinte eau : un outil pour les entreprises
Appliquée tout d’abord aux Etats, l’empreinte eau a rapidement été transposée aux entreprises. Si cette translation nécessite encore des adaptations de méthodologie, le principe reste le même : Il s’agit d’évaluer toute l’eau consommée directement et indirectement lors de la production d’un bien ou d’un service.
Evaluer l’empreinte eau de produits ou de services permet aux entreprises d’apprécier précisément leur degré de dépendance à cette ressource. Cette première étape réalisée, le bilan obtenu permet de mettre en place les actions nécessaires à une gestion durable de la ressource pour la société. L’empreinte eau peut également devenir un facteur d’aide à la prise de décision en indiquant aux décideurs le produit, le système ou la matière première le plus performant en termes d’eau. Il s’agit donc de fournir aux entreprises un outil capable de les aider à gérer au mieux cette nouvelle problématique environnementale.
Si la méthodologie est appelée à poursuivre son évolution, l’empreinte eau est un outil qui est d’ores et déjà utilisé par les entreprises. Il a été repris par les adeptes des ACV afin de le rendre plus pertinent, d’augmenter son niveau de précision et de faciliter sa lecture. En parallèle, ISO se livre à un nouvel exercice de rédaction au travers de la norme ISO / PWI* 14046 qui « établirait les principes, les exigences et les lignes directrices pour une mesure de l'empreinte eau des produits, processus et organisations, sur la base des indications sur l'évaluation de l'impact données dans ISO 14044 ».
La rapidité avec laquelle le monde de l’environnement s’est approprié ce nouveau concept et le besoin ressenti par les entreprises d’avoir un outil supplémentaire à leur disposition pour gérer ce nouvel enjeu laissent à penser que l’empreinte eau a un bel avenir devant elle.
*PWI : Preliminary Work Item