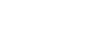Le Génie végétal de restauration des berges : des techniques écologiques et économiques en faveur de la biodiversité
Aujourd’hui, l'enjeu environnemental pour Voies Navigables de France (VNF) est d'adopter et d’intégrer dans ses pratiques des modes d'exploitation, de maintenance et d'entretien visant non seulement à compenser, mais aussi et surtout à supprimer ou à réduire les impacts sur la faune et flore. Développer une approche d'ingénierie écologique au plus près du terrain, en développant de nouveaux savoir-faire, peut permettre de relever ce défi. Le génie végétal de restauration des berges illustre cette tendance.
Christel Fiorina a réalisé dans ce cadre une mission professionnelle pour Voies navigables de France (VNF) sur la valorisation des fonctions et services écosystémiques tirés de la végétalisation des berges de canaux.
L’essor des mesures de protection de l’environnement a eu une résonance toute particulière pour la voie navigable, seule infrastructure considérée à la fois par le législateur comme un mode de transport à promouvoir (art. 11 de la loi du 3 août 2009 dite "Grenelle 1") et une trame bleue (art. 121 de la loi du 12 juillet 2012 dite« Grenelle 2 »). L'action d'un gestionnaire de canaux tel que Voies navigables de France s'inscrit donc dans un cadre réglementaire de plus en plus précis - loi sur l'eau, directive cadre sur l'eau, trames vertes et bleues …-, qu'il est nécessaire d'appréhender de façon optimale.
Voies navigables de France (VNF) est un établissement public sous tutelle du ministère du Développement Durable, chargé d’exploiter, d’entretenir et de moderniser un réseau d'environ 6500 km de canaux, dont près de 2000 km à grand gabarit. Son action s'inscrit dans un contexte de croissance du trafic fluvial depuis une dizaine d’années, la navigation commerciale intérieure ayant quasiment vu sa part modale doubler depuis 2000.
Aujourd’hui, l'enjeu environnemental pour VNF est d'adopter et d’intégrer dans ses pratiques des modes d'exploitation, de maintenance et d'entretien visant non seulement à compenser, mais aussi et surtout à supprimer ou à réduire les impacts sur la faune et flore. Développer une approche d'ingénierie écologique au plus près du terrain, en développant de nouveaux savoir-faire, peut permettre de relever ce défi. Le génie végétal de restauration des berges illustre cette tendance.
Le génie végétal : utiliser les fonctionnalités des plantes pour stabiliser une berge
Au cours du siècle dernier, les techniques de génie civil (béton, palplanches) ont été privilégiées pour stabiliser les berges de canaux. Leur facilité de mise en œuvre, couplée à des coûts jusqu'alors relativement modestes, les rendaient plus attractives. Le renchérissement des matières premières et la nécessité, inscrite dans la loi, de développer des corridors écologiques, mettent désormais en lumière les intérêts multiples d’une technique ancestrale redevenue attractive : le génie végétal appliqué à la restauration de berges de rivières et canaux.
Depuis une quinzaine d'années, VNF développe dans l’Est de la France un programme de restauration de ses berges au moyen de techniques végétales. Ce savoir-faire est un des piliers du système de management environnemental de la Direction territoriale du Nord-Est, certifiée ISO 14001 depuis 2005. Outre les études menées pour déterminer des profils de berge différents, le recours au génie écologique de restauration des berges fait aussi l’objet de suivis scientifiques ayant pour objectif de vérifier l’impact de ces procédés sur la qualité de l’eau, ainsi que la diversité et l’abondance de poissons dans les canaux ainsi restaurés.
Le génie végétal de reconstruction des berges repose essentiellement sur les propriétés mécaniques et physiques des plantes, notamment sur leur pouvoir d'enracinement. Les espèces végétales sont en premier lieu sélectionnées pour la qualité de leur système racinaire qui, en se développant sur des surfaces importantes et profondes dans le sol, permet de stabiliser la berge dans de façon pérenne. Les variétés couramment utilisées dans le Nord-Est de la France sont la baldingère faux-roseau, les carex ou la grande glycérie. Néanmoins, dans une logique de plus-value environnementale, un travail sur les mélanges grainier a été mené par les équipes de VNF pour enrichir la diversité végétale au bord de la voie d’eau. Ainsi, l’iris des marais, le souci d’eau ou encore la salicaire viennent désormais compléter le panel.
S’appuyant sur des matériaux naturels diversifiés (bois, géotextiles en coco, minéraux), le génie écologique de protection des berges offre de surcroît une grande palette de solutions techniques : plage végétale, boudins plantés d’hélophytes, caissons pré-végétalisés, techniques mixtes à base d’enrochement. Ainsi, le savoir-faire et le retour d’expérience accumulés ces dernières années permettent aujourd’hui d’intervenir sur des profils de berge très différents.
Développer le potentiel des écosystèmes grâce au génie écologique
Les intérêts de la végétalisation des berges sont multiples. Sur le plan économique, les coûts au mètre linéaire sont globalement inférieurs aux procédés classiques. Le bilan carbone d’une technique végétale « pure », c’est-à-dire réalisée à partir de matériaux vivants (sans enrochement), est par ailleurs 7 fois inférieur à celui d’une technique « dure ». Enfin, au plan écologique, ces techniques participent de la création ou de la reconstitution de continuités latérales entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Une donnée qui s’avère particulièrement intéressante dans une logique de constitution des trames vertes et bleues.
En effet, les berges redeviennent des zones de transition et d’interface entre l’eau et le sol, ce qui accroît leur potentiel écologique. Elles offrent des espaces d'abri, de nutrition et de reproduction pour une faune diversifiée : poissons, batraciens, oiseaux et mammifères d’eau. Les suivis écologiques menés sur les stations restaurées sur le réseau de Voies navigables de France ont en effet permis de mettre en évidence que certaines techniques ont un impact favorable sur la diversité et la productivité piscicoles, avec parfois la présence dans certains canaux d’espèces emblématiques exigeantes telles que la bouvière, le brochet ou le rotengle, que l'on retrouve rarement en milieu artificiel.
Ces résultats témoignent du fait que le génie écologique tend à restituer en canal les caractéristiques physiques et biologiques d’une berge naturelle. Cela signifie donc que les techniques alternatives de maintien des berges contribuent à une restauration des fonctions des voies navigables.
In fine, la berge naturalisée est susceptible de produire des services dits écosystémiques utiles à l’Homme : services d'approvisionnement (pêche, production de biomasse), services de régulation (rétention des eaux dans le sol, alimentation des nappes phréatiques, phyto-épuration), activités culturelles et de loisir (pêche de loisir, promenade, découverte de la nature, sensibilisation à l’environnement).
En ce sens, on s’aperçoit que le canal aux berges végétalisées rend une multitude de services directement contributeurs au bien-être humain. Dans cette acception, la voie navigable, infrastructure dédiée essentiellement au transport de marchandises et à la plaisance, doit être considérée une voie d’eau, infrastructure et écosystème intégré dans son territoire et offrant une palette de services à un nombre très large de parties intéressées.
En conclusion, le développement de l’ingénierie écologique d’aménagement de berges de canaux présente des atouts qui dépassent le simple cadre du management environnemental.
Sur le plan technique, ces procédés en devenir disposent d’un terrain d’expérimentation vaste, propice à un travail de recherche et de développement. D’un point de vue économique, les aménagements de berges s’avèrent au final moins coûteux pour une durabilité tout aussi satisfaisante, à partir du moment où un suivi rigoureux du bon enracinement des plantes est réalisé dans les deux à trois années qui suivent la restauration. D’un point de vue écologique enfin, les techniques végétales permettent de recréer des continuités latérales entre le canal et le milieu terrestre et améliorent le potentiel de « l’écosystème voie d’eau ». Les techniques alternatives de réparation des berges représentent donc aujourd’hui de réelles solutions à la disposition des concepteurs d’infrastructures fluviales.
Texte : Christel Fiorina
Crédits photo : VNF